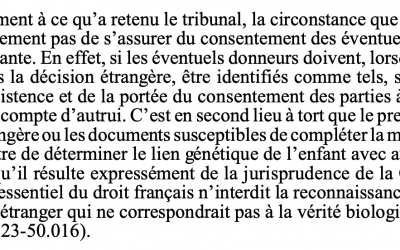PMA Post mortem : il faut changer la loi : réflexions sur les arrêts de la cour d’appel de Paris du 14 octobre 2025
La cour d’appel de Paris dans deux décisions du 14 octobre 2025 a écarté l’application de l’article L2142-2-1° et ainsi donné un effet juridique à la PMA post mortem, ce que j’interprête comme un appel du pied au législateur pour changer la loi actuelle et que j’explique dans cette tribune publié dans le Monde daté du 23 octobre.
“Le 14 octobre, la cour d’appel de Paris a reconnu pour la première fois en France un lien de filiation entre un père décédé et son enfant né d’une procréation médicalement assistée (PMA) post mortem, pratiquée à l’étranger.
En France, la PMA post mortem est interdite depuis 1994. La question a bien été débattue lors de la dernière révision de la loi de bioéthique, en 2021, mais la porte ne s’est pas ouverte : le décès de l’un des membres du couple rend le projet parental caduc, même si le défunt a donné par écrit son accord pour que ses gamètes puissent être utilisés dans le cadre du projet parental interrompu par sa mort.
Dans une Europe composée de pays aux législations différentes et dont l’un des piliers est la libre circulation des Européens, des veuves sont parties à l’étranger – en Espagne, en Belgique – pour réaliser le projet conçu à deux, avant l’accident ou la maladie. C’est ainsi qu’elles ont bénéficié d’une PMA post mortem, permettant ensuite la naissance, là-bas ou en France, d’un enfant qui a une mère et pas de père.
La cour d’appel de Paris est venue donner un père à l’enfant, et a placé l’intérêt de ce dernier au cœur de sa décision. Le raisonnement de la cour d’appel est clair : il ne s’agit pas d’encourager la PMA post mortem, mais de protéger l’enfant qui en est issu. Refuser de reconnaître un lien de filiation avec son père, alors même que celui-ci avait exprimé son accord de son vivant, revenait à priver l’enfant d’une filiation, c’est-à-dire d’un élément constitutif, essentiel, de son identité – sans même parler de l’héritage.
C’est au nom du droit de l’enfant à être protégé par l’existence d’un lien de filiation qui n’a pas pu être établi en raison d’un événement tragique – la mort brutale et inattendue du père – que la cour a écarté l’application de l’article L2141-2-1, qui interdit la PMA post mortem. Le juge a considéré qu’il aurait été, dans ce cas précis, plus dommageable pour l’enfant de suivre cette règle plutôt que d’y déroger.
En d’autres termes, la cour a fait prévaloir les garanties posées par la Convention européenne des droits de l’homme et appliquées par la Cour européenne des droits de l’homme, dans ses arrêts Mazurek en 2000 et Wagner en 2007, selon lesquels un enfant ne doit pas être discriminé en raison des conditions de sa naissance.
La cour d’appel, si elle n’a pas légalisé la PMA post mortem, a considéré que le droit de l’enfant prime sur l’interdiction de cette dernière. En conséquence, nous nous retrouvons dans une situation paradoxale où la pratique demeure interdite en France, mais ses conséquences peuvent désormais être reconnues légalement lorsque la conception a eu lieu à l’étranger.
Des garanties claires
Les réserves à l’égard de la PMA post mortem sont connues. Il y a d’abord la question du consentement : le défunt voulait-il vraiment devenir père après sa mort ? Sans trace écrite, le risque d’abus existe. Il y a ensuite la question du deuil : donner naissance après la mort du conjoint va-t-il aider la veuve à sortir de l’affliction, ou au contraire prolonger la souffrance ? Sans oublier la question plus philosophique : celle d’un enfant conçu sans père vivant, dans une société qui déplore souvent l’absence de repères.
Pourtant, aucun de ces arguments n’est insurmontable. Sur la question de l’intention du défunt, la loi pourrait imposer un consentement écrit et encadrer la réalisation de la procréation dans un certain délai – de six mois à deux ans –, comme le font nos voisins qui ont autorisé la PMA post mortem. Sur la question de l’enfant qui n’aura qu’un seul parent, dès lors que la loi française autorise la PMA à une femme célibataire, il est paradoxal de refuser à une veuve de poursuivre le projet parental commun qui aboutira lui aussi à la naissance d’un enfant qui n’aura qu’un seul parent.
A terme, ce paradoxe va devenir intenable : comment continuer à interdire en France ce que la justice française finit par reconnaître une fois réalisé ailleurs ? Le législateur est à la croisée des chemins. Les exemples de législations existent. L’Espagne, la Belgique ou le Royaume-Uni encadrent la PMA post mortem avec des garanties claires : consentement explicite du défunt, délai minimal de réflexion pour la conjointe survivante, suivi psychologique, contrôle médical strict. Rien n’interdit à la France de s’inspirer de ces modèles, plutôt que de laisser les tribunaux combler le vide.
La décision du 14 octobre ne crée pas une révolution, mais elle fait bouger les lignes de la loi. En reconnaissant la filiation post mortem, la justice rappelle au législateur que le droit à l’identité de l’enfant n’est pas négociable. Elle sait que sa décision sera interprétée comme un appel à une réforme claire de la loi bioéthique : autoriser la PMA post mortem sous conditions précises afin de concilier l’éthique du vivant et la protection de l’enfant posthume.
La mort ne doit pas être instrumentalisée, mais elle ne doit pas non plus effacer le projet de vie qu’un couple a formé. Dans une société qui reconnaît désormais la pluralité des familles et des parcours parentaux, il serait incohérent de refuser le droit d’avoir un père à un enfant simplement parce que sa naissance défie la chronologie habituelle.
La décision du 14 octobre ne clôt pas le débat. Elle le relance et indique une direction claire : celle d’un droit qui, sans renier ses principes, choisit de regarder la vie là où elle est née, même après la mort ».